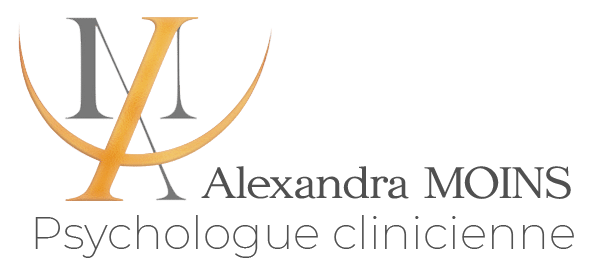Interrogée récemment par une étudiante en journalisme sur le thème du harcèlement scolaire et sur l’impact des nouvelles technologies pour la victime de harcèlement, il m’a semblé intéressant d’apporter ici un éclairage complémentaire sur cette problématique dont la...
Revue de presse
Une psychologue intervient auprès de trois témoignages de harcèlement sexuel: magazine Nous Deux – Novembre 2012
Alors que le flou (et même le vide) juridique qui entoure le harcèlement sexuel a été partiellement dissipé avec la nouvelle version de la loi sur le harcèlement du 6 Aôut 2012, les cas de harcèlements, qu’ils soient d’ordre moral ou sexuel, restent particulièrement...
Août 2012: Interview sur les ressorts psychologiques de l’infanticide – Journal d’information Atlantico
Retrouvez l’interview donnée par Alexandra MOINS au sujet de quelques facteurs psychologiques à l’oeuvre dans l’infanticide. Cet article fait suite à l’étude sur le phénomène de l’infanticide menée et dont les principales tendances ont été publiées sur ce blog....
Le viol et le psychologue: réflexions suite à l’interview dans le Figaro du 06 Juillet 2011
Une journaliste du Figaro a souhaité obtenir certains éclaircissements relatifs aux mécanismes à l’oeuvre chez les victimes d’ agressions sexuelles. L’interview prenant place dans le contexte sensible des accusations envers DSK, je profite de cette occasion pour...