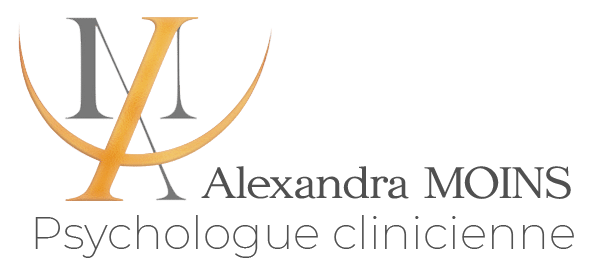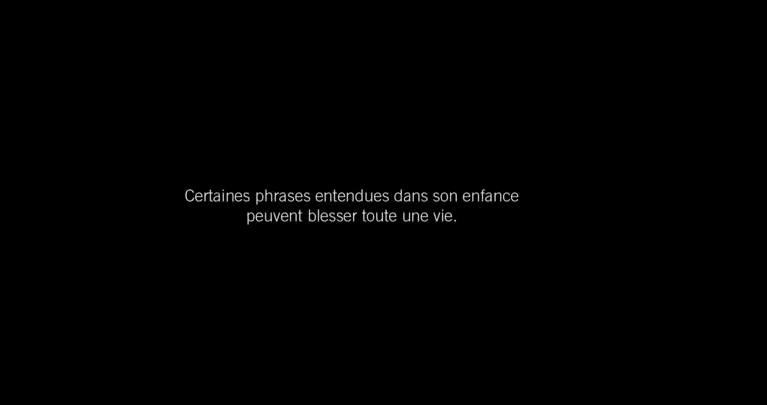L'hypersensibilité est un phénomène psychologique complexe, souvent mal compris, qui ne se limite pas à une simple amplification des émotions. Elle s'inscrit dans un spectre plus large de réactivité physiologique et psychique face aux stimuli sensoriels, émotionnels...
Thérapies individuelles
L’addiction aux écrans des enfants et adolescents: impacts psychologiques et stratégies parentales
L'addiction aux écrans : impact prolongé sur le psychisme des enfants et adolescents et stratégies parentales pour mieux l'appréhender L'évolution technologique a transformé l'accès aux écrans en une habitude omniprésente chez les enfants et adolescents. Bien que ces...
La perversion au féminin:
Cet article s’intéresse aux mécanismes de perversion au féminin. Tandis que le spectre du pervers narcissique est au coeur de très nombreux échanges, on oublie bien souvent que ce dernier n’est pas invariable en genre. Si l’image de l’homme pervers est bien ancrée dans les esprits, la femme manipulatrice est capable de dégâts tout aussi destructeurs.
ADULTE A HAUT POTENTIEL, SURDOUE OU « ZEBRE »
Contrairement aux idées reçues, posséder une intelligence exceptionnelle n’est pas une garantie de bonheur et de réussite.
La peur de l’abandon: comment en sortir?
La peur de l’abandon est un phénomène qu’on retrouve de façon plus au moins marquée chez l’être humain. Ne vous est-il jamais arrivé de vous sentir profondément seul au point d’avoir le sentiment d’être au bord d’un précipice et qu’au fond de celui-ci il n’y a que...
Lancement d’une campagne sur « les mots qui blessent »
Les associations Observatoire de la violence éducative ordinaire (Oveo) et Stop VEO Enfance sans violences lancent ces jours-ci une campagne inédite sur "les mots qui blessent". La campagne de sensibilisation s'attache à dénoncer une forme de "violence éducative...
Parentification, quand la relation parent enfant est inversée
Dans la relation d’accaparement, le parent dépose chez l’enfant toutes ses angoisses ce qui va mobiliser chez lui toutes ses ressources pour le secourir. Progressivement l’enfant va devoir se positionner en adulte pour répondre aux besoins du parent. C’est ainsi que l’enfant se trouve parent de ses parents. C’est ce qu’on appelle la « parentification » .
Le harcèlement à l’école, violence et traumatisme
Cet article vise à revenir sur le sujet ô combien sensible du harcèlement à l’école. Un sujet d’autant plus intéressant à aborder actuellement puisqu’une grande campagne de sensibilisation vient d’être lancée. CAS DE HARCELEMENT SCOLAIRE : POURQUOI CONSULTER UN...
Thérapie individuelle chez les enfants de moins de 6 ans
Il est souvent difficile d’entreprendre un travail chez l’enfant en bas âge. Les difficultés d’élaboration et le fait que les stades de développement varient fortement à ces âges rendent souvent compliqués un travail de fond. Pourtant cette période est la plus propice...